B.O.I. 25 septembre 1991
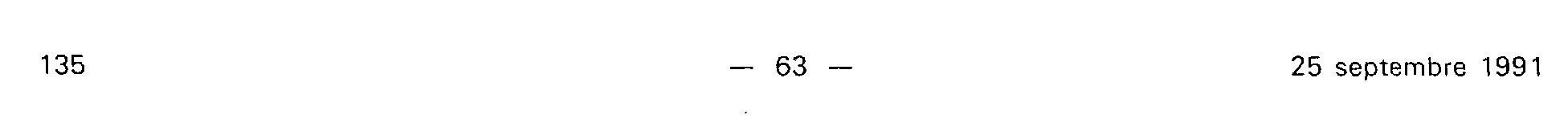
BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS
6 L-4-91
25 septembre 1991
Note du 9 septembre 1991
Détermination des projets de valeurs à l'hectare sectorielles des propriétés bâties.
NOR : BUD L 91 00 139 J
[DGI - Bureau III B 1]
|
Après la définition de la classification départementale et le découpage en secteurs d'évaluation, la détermination des valeurs à l'hectare sectorielles constitue la troisième phase des opérations de révision des évaluations cadastrales des propriétés non bâties (articles 19 et 20 de la loi n° 90-669 du 30 juillet 1990). La valeur à l'hectare sectorielle est définie par sous-groupe et par secteur d'évaluation. En règle générale, à l'exception des natures de cultures spécifiques (par exemple vins d'appellation contrôlée, attachés à des aires de production), chaque sous-groupe de la classification départementale doit recevoir une VHS dans chacun des secteurs. En principe, la valeur à l'hectare sectorielle d'un sous-groupe est déduite de la moyenne des données fournies par les actes de location concernant les propriétés ou les cultures de ce sous-groupe situées dans le secteur d'évaluation (méthode de la moyenne). Cependant, en l'absence d'actes de location, ou lorsque ceux-ci sont en nombre insuffisant ou ne peuvent valablement être retenus, la valeur à l'hectare est déterminée par comparaison avec celle adoptée pour un autre sous-groupe, ou pour le même sous-groupe dans un autre secteur ou département (méthode de la comparaison). L'évaluation des propriétés des groupes 1 (terres de culture et d'élevage) et 2 (lacs, étangs) fait le plus souvent appel à la méthode de la moyenne. En raison de leurs caractéristiques de marché (prédominance du faire-valoir direct sur le fermage), l'évaluation des groupes 3 (vignes) et 4 (vergers) doit également faire appel à la méthode de la comparaison. De même dans le cas où un sous-groupe représente une faible superficie dans un secteur (moins de 1 pour 1000 de la superficie départementale du sous-groupe), son évaluation doit être de préférence déterminée par comparaison avec celle qui a été fixée pour le même sous-groupe dans un autre secteur d'évaluation. La présente instruction expose les modalités d'évaluation propres aux différents groupes à l'exception de celles afférentes aux propriétés boisées qui font l'objet d'une instruction particulière (voir note du 6 septembre 1991, 6 L-3-91 ). • |
||||
|
I - EVALUATION DES PROPRIETES DU GROUPE 1 (TERRES DE CULTURE ET D'ELEVAGE) ET DU GROUPE 2
(LACS, ETANGS)
A - EVALUATION PAR LA METHODE DE LA MOYENNE
L'article 19-I de la loi précise que « la valeur à l'hectare d'un sous-groupe de cultures ou de propriétés est égale au montant annuel d'un bail moyen à l'hectare, déterminé par référence aux baux en vigueur pour ce sous-groupe dans le secteur d'évaluation à la date de référence de la révision.
Pour l'application de cette disposition, il n'est pas tenu compte de la part des loyers afférents aux bâtiments à usage d'habitation 1 dont les baux prévoient la mise à disposition du preneur ».
Des travaux préalables aux premières opérations de la révision des évaluations cadastrales des propriétés non bâties ont conduit à l'analyse des actes de location : recensement, calcul du montant brut du bail, corrections à apporter à ce montant et détermination de la valeur moyenne du bail.
Cette analyse a d'abord porté sur les baux à ferme, puis sur les actes de location verbale ; lorsque ces contrats étaient inexistants ou en nombre insuffisant, ou ne représentaient pas les caractéristiques de marché de certaines cultures ou propriétés, elle a été étendue aux contrats de métayage.
Lorsque la plupart des contrats sont spécifiques à une ou plusieurs natures de cultures d'un même sous-groupe, l'évaluation de ce sous-groupe pourra être déduite de la valeur moyenne des contrats. Mais lorsque les contrats portent sur des natures de cultures relevant de différents sous-groupes, il sera nécessaire de dégager la valeur propre aux natures de cultures des différents sous-groupes à évaluer.
1. Sous-groupes dont l'évaluation peut relever de contrats spécifiques
a) détermination du projet de valeur à l'hectare sectorielle
Pour de tels sous-groupes, la valeur à l'hectare sectorielle résulte de la moyenne des valeurs issues des contrats de location, pondérées par leur superficie respective.
Ainsi pour le sous-groupe des terres de polyculture, qui a été pris en compte pour la délimitation des secteurs d'évaluation agricole, cette valeur est égale à la valeur moyenne sectorielle (VMS).
Mais lorsque les conditions locales de marché exigent de créer un sous-groupe des prés distinct de celui des terres, il est nécessaire de dégager les contrats spécifiques aux prés de ceux concernant les terres, préalablement au calcul de la moyenne.
Si des contrats spécifiques à chacune de ces natures de culture ne pouvaient être trouvés, et dans l'hypothèse où la C.D.E.C. déciderait de maintenir la distinction entre terres et prés, la même VHS pourrait être proposée pour le sous-groupe des terres et pour celui des prés.
b) Corrections éventuelles à apporter au projet de valeur à l'hectare sectorielle
o par rapport à la représentativité des baux
Les projets de valeurs à l'hectare sectorielles sont, dans un premier temps, établis à partir d'échantillons de propriétés dont la représentativité n'est pas nécessairement assurée à l'échelle du secteur d'évaluation. Ces échantillons peuvent en effet ne concerner que les meilleures propriétés ou les meilleures classes de cultures, ou, à l'inverse, les plus mauvaises.
Aussi avant d'arrêter définitivement leurs projets de valeurs à l'hectare sectorielles, les services devront s'assurer que les valeurs ainsi déterminées reflètent la qualité moyenne de l'ensemble des propriétés du secteur d'évaluation.
A défaut, ils devront y apporter un correctif.
Cette correction concernera essentiellement les terres de polyculture. Pour des sous-groupes plus spécifiques, la question de la représentativité des baux est moins importante puisque le nombre de classes qu'ils comportent actuellement est généralement limité à une ou deux.
A cette fin, les services choisiront quelques communes, si possible réparties géographiquement sur l'ensemble du secteur, représentatives des caractéristiques agroéconomiques et des conditions de marché.
Si le nombre des communes à examiner est laissé à leur appréciation (moins de cinq devrait suffire), les services devront cependant retenir celles qui répondent à au moins trois des critères suivants :
- posséder un nombre de baux supérieur à la moyenne du nombre des baux retenus pour la détermination des VMS (valeur moyenne sectorielle ; voir note du 11 février 1991 6 L-2-91 sur la mise en place des secteurs d'évaluation).
- avoir des superficies cadastrées comparables ;
- avoir une valeur moyenne communale proche de la valeur moyenne sectorielle ;
- posséder des tarifs communaux actuels peu éloignés des tarifs les plus représentés dans les communes relevant du secteur.
Les services devront alors comparer le revenu cadastral moyen au 1 er janvier 1990 tel qu'il ressort pour les sous-groupes à évaluer de l'état 6035 NM, au revenu cadastral moyen de l'échantillon de contrats ruraux.
Dès lors que ces deux revenus cadastraux seraient trop divergents, les projets de valeurs à l'hectare sectorielles pourraient être amendés en appliquant un coefficient correcteur aux valeurs moyennes issues des actes de location.
Le coefficient correcteur d'une commune est égal au rapport entre le revenu cadastral moyen de la commune à la date du 1 er janvier 1990, et le revenu cadastral moyen de l'échantillon relatif à cette commune.
Pour un sous-groupe, le coefficient correcteur du secteur résulte de la moyenne des coefficients déterminés pour les communes représentatives du secteur, pondérée par la superficie cadastrée de chaque commune afférente aux classes des natures de culture actuelles qui font l'objet des baux étudiés.
Le projet de valeur à l'hectare sectorielle amendé est alors égal à :
VHS = valeur moyenne issue des actes de location x coefficient correcteur
Un exemple de calcul de ce coefficient est donné en annexe 1.
o par rapport à l'évolution des prix de location
L'évaluation cadastrale doit refléter une situation moyenne au le' janvier 1990. Aussi est-il nécessaire de faire abstraction des circonstances extraordinaires ou passagères dont l'influence sur le cours des loyers ne serait que de nature accidentelle.
A défaut, dans certains secteurs d'évaluation, les sous-groupes concernés risqueraient d'être durablement défavorisés ou favorisés, après la révision, quant à l'importance de leur participation aux budgets locaux.
Si l'étude des baux faisait apparaître que des facteurs conjoncturels sont à l'origine, pour un sous-groupe donné, d'une évolution très divergente dans un secteur de ce qu'elle est dans les autres secteurs du département, le projet de VHS tel qu'il ressort des actes de location pourrait être amendé en éliminant l'effet de ces facteurs.
Quant aux tendances durables elles pourraient être appréciées en étudiant la pente de la droite représentant la valeur au 1 er janvier 1990 du bail moyen à l'hectare 2 en fonction de la date de conclusion des contrats de location.
Ainsi pour les communes précédemment étudiées (voir ci-dessus), les services établiront un graphe, présentant en abscisse les années de conclusion des contrats, et en ordonnée le bail moyen à l'hectare au 1 er janvier 1990 correspondant aux années de conclusion des contrats.
Dès lors que le graphe fait nettement apparaître une évolution croissante ou décroissante, une réduction ou une augmentation pourra être appliquée au projet de VHS de façon à atténuer l'influence des facteurs conjoncturels et à représenter, au travers de la VHS, le niveau de moyen terme des contrats ruraux.
Un exemple de détermination de ce correctif est donné en annexe 2.
La mise en oeuvre de ces correcteurs ne devrait pas induire de modification dans la hiérarchie des secteurs issus d'une même région de base. Si les coefficients calculés conduisaient à ce résultat, il y aurait lieu de s'interroger sur la représentativité des communes choisies pour déterminer ces coefficients et, au besoin, de remettre ce choix en cause à moins que cette inversion ne résulte du caractère déterminant des potentialités agricoles dans la détermination du secteur.