B.O.I. N° 48 du 14 mars 1979
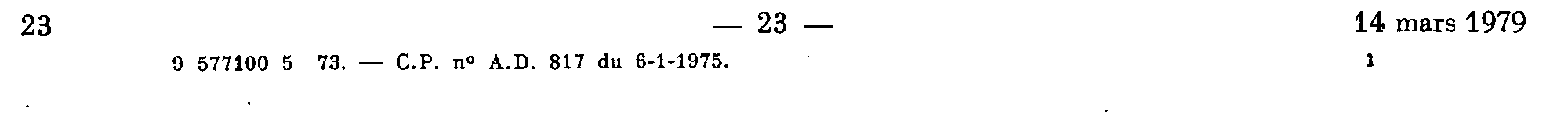
BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS
14 B-3-79
N° 48 du 14 mars 1979
14 A.I./3
Instruction du 26 février 1979
CONVENTIONS DESTINÉES A ÉVITER LA DOUBLE IMPOSITION
EN MATIÈRE D'IMPÔTS DIRECTS ET SUR LA FORTUNE
DISPOSITIONS PRÉVUES PAR LA CONVENTION FISCALE DU 29 MARS 1974
ENTRE LA FRANCE ET LE SÉNÉGAL
(Service de la législation fiscale)
[Sous-direction E - Bureau E 2]
|
GÉNÉRALITÉS
1.La loi n° 75-1181 du 19 décembre 1975 (J. O. du 21 décembre 1975) a autorisé l'approbation de la convention signée à Paris le 29 mars 1974, entre la France et le Sénégal, tendant à éviter les doubles impositions et à établir des règles d'assistance réciproque en matière d'impôts sur le revenu, d'impôts sur les successions, de droits d'enregistrement et de droits de timbre.
Le décret n° 76-1072 du 17 novembre 1976 (J.O. du 30 novembre 1976) complété par le décret n° 78-584 du 3 mai 1978 (J.O. du 11 mai 1978) a publié cette convention dont le texte est reproduit dans la présente série (B.O.D.G.I. 14 A-3-77. et 14 A-4-78 ).
2.Dans l'ensemble, le texte de cet accord, assez proche des conventions déjà en vigueur avec les autres États francophones d'Afrique ne comporte que quelques modifications par rapport à la convention à laquelle il se substitue.
Plus particulièrement, font l'objet de dispositions nouvelles 1 :
- la portée territoriale de la convention qui s'applique également aux zones situées hors des eaux territoriales sur lesquelles chacun des deux États exerce sa souveraineté (cf. § 222) ;
- les modalités de détermination de la quote-part de frais généraux du siège imputable aux établissements stables des entreprises du fait de la possibilité de procéder à des ajustements en la matière par la voie de la procédure d'entente amiable entre États (cf. § 2332.3 ) ;
- l'imposition des dividendes de source française versés à des bénéficiaires domiciliés au Sénégal, qui se voient accorder, dans certaines conditions, le bénéfice de l'avoir fiscal (cf. § 2353.1 - A - a ) ;
- enfin, le partage du droit de prélever l'impôt de distribution par l'ouverture d'une possibilité nouvelle d'imposition (cf. § 234-2).
Les aspects essentiels de la convention relatifs à l'imposition des revenus et de la fortune sont examinés dans la présente instruction sous six rubriques, dont les quatre principales suivantes :
- champ d'application de la convention ;
- règles concernant l'imposition des différentes catégories de revenus ;
- modalités pour éviter la double imposition ;
- dispositions diverses.
3.Par ailleurs, les mesures relatives à la procédure d'entente et de règlement prévues par la convention en cas de difficultés d'application du texte sont commentées à la division F et celles concernant l'assistance administrative, à la division G.
CHAMP D'APPLICATION DE LA CONVENTION
Personnes auxquelles s'applique la convention.
Aux termes de l'article 1 er de la convention, celle-ci s'applique aux personnes physiques, aux personnes morales et à tous les groupements de personnes physiques n'ayant pas la personnalité morale. Cette dernière expression désigne notamment, du côté français, les sociétés en participation régies par les articles 419 à 422 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales et mentionnées à l'article 206-3 et 4 du Code général des Impôts.
Définition du domicile (art. 2).
En ce qui concerne les personnes physiques, le domicile est, en principe, réputé situé au lieu du « foyer permanent d'habitation », cette expression désignant le centre des intérêts vitaux, c'est-à-dire le lieu auquel le contribuable est attaché par les relations personnelles les plus étroites.
Lorsqu'il n'est pas possible de localiser le domicile d'après ce critère, la personne physique est alors réputée posséder son domicile dans celui des deux États où elle séjourne le plus longtemps. En cas de séjour d'égale durée dans les deux États, elle est réputée avoir son domicile dans celui des deux États dont elle est ressortissante.
Si elle n'est ressortissante d'aucun d'eux, les autorités administratives des deux États doivent s'entendre pour trancher la difficulté (conv., art. 2, § 1).
Quant aux personnes morales, elles sont domiciliées au lieu de leur siège social statutaire, les groupements de personnes physiques n'ayant pas la personnalité morale étant, pour leur part, considérés comme ayant leur domicile au lieu du siège de leur direction effective ( conv., art. 2, § 2 ).
Portée territoriale de la convention.
D'après l'article 1 er , § 2, de la convention, celle-ci s'applique :
- d'une part, aux départements européens et d'outre-mer de la République française ;
- d'autre part, aux territoires de la République du Sénégal.
En outre, les effets de la convention sont étendus aux zones situées hors des eaux territoriales de chacun des deux États sur lesquelles, en conformité avec le droit international et selon leur législation, la France et le Sénégal peuvent exercer les droits relatifs au lit de la mer, au sous-sol marin et à leurs ressources naturelles.
Impôts visés par la convention.
1.L'article 8, § 1, précise que la convention est applicable aux impôts sur le revenu perçus pour le compte de chacun des États contractants et de ses collectivités locales quel que soit le système de perception.
2.Doivent être considérés comme impôts sur le revenu, les impôts perçus sur l'ensemble du revenu ou sur un ou plusieurs de ses éléments, y compris l'impôt sur les plus-values.
3.Les impôts actuels auxquels s'applique expressément la convention sont :
a. En ce qui concerne la France :
- l'impôt sur le revenu ;
- l'impôt sur les sociétés ;
- l'imposition forfaitaire annuelle sur les personnes morales ;
- ainsi que toutes retenues, tous précomptes et avances décomptés sur ces impôts.
b. En ce qui concerne le Sénégal :
- l'impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux et sur les bénéfices de l'exploitation agricole ;
- l'impôt minimum forfaitaire sur les sociétés ;
- l'impôt sur les bénéfices des professions non commerciales ;
- l'impôt sur les revenus des valeurs et capitaux mobiliers ;
- l'impôt général sur le revenu ;
- la contribution foncière des propriétés bâties ;
- la taxe de développement ;
- le prélèvement sur les salaires et la cotisation des employeurs pour l'amélioration de l'habitat.
4.Il est prévu que la convention s'appliquera aussi aux impôts futurs de nature identique ou analogue qui s'ajouteraient aux impôts actuels ou les remplaceraient ( conv., art. 8, § 4 ).
RÈGLES CONCERNANT L'IMPOSITION DES DIFFÉRENTES CATÉGORIES DE REVENUS
Revenus immobiliers.
Définition.
1.En application du premier alinéa de l'article 4 de la convention, sont considérés comme biens immobiliers les droits auxquels s'applique la législation fiscale concernant la propriété foncière y compris les droits d'usufruit sur les biens immobiliers. Sont cependant exclues de cette définition les créances de toute nature garanties par gage immobilier.
2.Par ailleurs, le deuxième alinéa de l'article 4 de la convention précise que la notion de biens immobiliers est définie conformément au droit de l'État où est situé le bien considéré.
3.Cette référence à la législation interne - fiscale et générale - confirme du côté français le droit de taxes dans le cadre de la règle de territorialité posée par l'article 9 de la convention (cf. ci-dessous n° 2312) tous les revenus et produits des biens immobiliers lorsque la législation française le prévoit (sur ce point, voir les incidences de la loi n° 76-660 du 19 juillet 1976, instruction du 30 décembre 1976, § 70 et suivants, B.O.D.G.I. 5 C-1-76 ou 8 M-1-76) ..
Règles d'imposition.
Conformément aux dispositions de l'article 9 de la convention, l'imposition des revenus des biens immobiliers est attribuée à l'État où ces biens sont situés.
Plus-values immobilières.
La règle exposée au paragraphe 2312 s'applique également selon l'acception propre a la législation française aux plus-values immobilières visées aux articles 150 A à 150 T, 235 quater, 238 octies à terdecies, 244 bis et 244 bis A du Code général des Impôts dans leur rédaction applicable depuis le 1 er janvier 1977 (loi n° 76-660 du 19 juillet 1976) [cf. avant le 1 er janvier 1977, C.G.I., art. 150 ter à quinquies, 235 quater, 238 octies à undecies et 244 bis).
Bénéfices agricoles.
La règle d'imposition dans l'État de situation des biens (cf. n° 2312) est également applicable, conformément aux dispositions de l'article 9 de la convention, aux revenus provenant des exploitations agricoles et forestières.
Les bénéfices produits par ces entreprises sont imposables, dans chaque État, dans les conditions prévues par la législation interne.
Bénéfices industriels et commerciaux.
A l'exception des revenus provenant des entreprises de navigation aérienne visées ci-après (cf. 2333), les bénéfices industriels et commerciaux sont imposables dans l'État sur le territoire duquel -se trouve un établissement stable de l'entreprise (conv., art. 10, § 1 ).
Définition de l'établissement stable.
1.Aux termes de l'article 3 de la convention, l'expression « établissement stable » désigne une installation fixe d'affaires où une entreprise exerce tout ou partie de son activité.
2.La convention franco-sénégalaise comporte une définition relativement large de l'établissement stable. Ainsi, l'article 3 de cet accord précise que constituent notamment des « établissements stables », un siège de direction, une succursale, un bureau, une usine, un atelier, une mine, carrière ou autre lieu d'extraction de ressources naturelles, un chantier de construction ou de montage sans fixation d'une durée minimum.
De même sont considérés comme des établissements stables d'une entreprise :
- un dépôt de marchandises entreposées aux fins de stockage, exposition ou livraison ;
- une installation fixe d'affaires utilisée soit aux fins de stockage, livraison et exposition de marchandises appartenant à cette entreprise, soit aux fins d'acheter des marchandises ou de réunir des informations faisant l'objet de l'activité de cette entreprise, soit à des fins de publicité ;
- un agent dépendant disposant de pouvoirs lui. permettant de conclure des contrats au nom de cette entreprise.
3.En revanche, ne constituent pas des établissements stables les dépôts de marchandises entreposées aux seules fins de transformation par une autre entreprise ou les installations fixes d'affaires effectuant des opérations ayant seulement un caractère préparatoire pour l'entreprise.
4.Les paragraphes d, e et f du même article 3 précisent, au regard de la notion d'établissement stable, la situation des entreprises d'assurances, des entreprises utilisant le concours d'intermédiaires autonomes et des entreprises associées.
Détermination du bénéfice imposable.
1.Les bénéfices industriels et commerciaux réalisés par une entreprise de l'un des États contractants sur le territoire de l'autre État, sont imposables dans cet autre État, mais seulement dans la mesure où les bénéfices sont imputables à l'établissement stable qui se trouve situé dans cet autre État (art. 10, § 1 et 2).
2.Le bénéfice de l'établissement stable est déterminé dans les conditions fixées aux paragraphes 3 à 6 de l'article 10.
Le bénéfice de l'établissement stable, déterminé d'après les résultats de la comptabilité, doit correspondre au bénéfice que cet établissement aurait normalement réalisé s'il avait constitué une entreprise autonome - le bénéfice de l'établissement stable comprend donc, le cas échéant, les bénéfices qui auraient dû normalement lui être affectés mais qui ont été indirectement transférés à d'autres entreprises ou à d'autres établissements de l'entreprise - (cf. art. 10, § 3 et 11).
3.Conformément au paragraphe 4 de l'article 10, une quote-part des frais généraux du siège est imputée sur les résultats des différents établissements stables, au prorata du chiffre d'affaires réalisé par chacun d'eux.
Mais, lorsque cette règle de répartition ne permet pas de dégager un bénéfice normal ou lorsqu'elle conduit à attribuer à un établissement stable une quotre-part sensiblement supérieure à celle qui résulterait de l'application de la législation interne de l'État où est situé cet établissement stable, les autorités compétentes des deux États peuvent d'un commun accord procéder aux ajustements nécessaires.
4.A défaut de comptabilité distincte, le bénéfice imputable à chacun des établissements stables que l'entreprise possède dans les deux États peut être déterminé par répartition des résultats globaux de l'entreprise au prorata du chiffre d'affaires réalisé dans chacun d'eux (art. 10, § 5).
5.Lorsque l'établissement stable ne réalise pas de chiffre d'affaires, ou lorsque l'activité qu'il exerce n'est pas comparable à celle des autres établissements de l'entreprise, les autorités compétentes des deux États s'entendent pour déterminer les conditions d'application des paragraphes 4 et 5 de l'article 10 (détermination de la quote-part de frais de siège [cf. § 3 ci-dessus] et ventilation des bénéfices).
6.Dans de telles hypothèses, il conviendra de saisir le service de la Législation fiscale, sous-direction E, bureau E 2, des difficultés rencontrées, en fournissant tous les éléments d'information nécessaires afin que l'administration fiscale sénégalaise puisse en être valablement saisie.