B.O.I. N° 000 du 27 novembre 1975
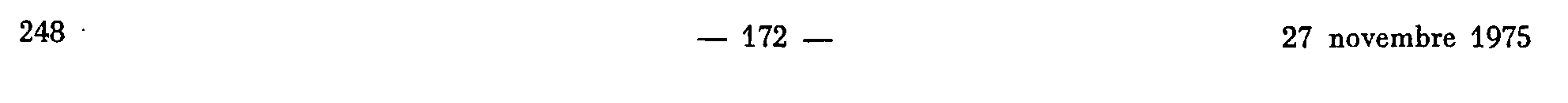
BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS
14 B-9-75
N° 000 du 27 novembre 1975
14 A.I./16
Instruction du 20 octobre 1975
CONVENTIONS DESTINÉES A ÉVITER LA DOUBLE IMPOSITION
EN MATIÈRE D'IMPÔTS DIRECTS SUR LE REVENU ET LA FORTUNE
DISPOSITIONS PRÉVUES PAR LA CONVENTION FISCALE
DU 22 SEPTEMBRE 1972 ENTRE LA FRANCE ET LE MALI
[Sous-direction III E - Bureau III E 2]
|
GÉNÉRALITÉS
1.La loi n° 73-1114 du 20 décembre 1973 (J. O. du 21 décembre 1973) a autorisé l'approbation de la convention signée à Paris le 22 septembre 1972 entre la France et le Mali, tendant à éviter les doubles impositions et à établir des règles d'assistance réciproque en matière d'impôts sur le revenu, d'impôts sur les successions, de droits d'enregistrement et de droits de timbre.
Le décret n° 75-366 du 12 mai 1975 (J. O. du 17 mai 1975) a publié cette convention dont le texte est reproduit dans la présente série (B.O.D.C.I. 14 A-3-75).
2.Dans l'ensemble, le texte de cet accord, inspiré des dispositions de la convention-type élaborée par le Comité fiscal de l'O.C.D.E. est également assez proche des conventions déjà en vigueur avec les autres États francophones d'Afrique.
Les aspects essentiels de la convention relatifs à l'imposition des revenus et de la fortune sont examinés dans la présente instruction sous les quatre principales rubriques suivantes :
- champ d'application de la convention ;
- règles concernant l'imposition des différentes catégories de revenus ;
- modalités pour éviter la double imposition ;
- dispositions diverses.
3.Par ailleurs, les mesures relatives à la procédure d'entente et de règlement prévues par la convention en cas de difficultés d'application du texte sont commentées à la division F et celles concernant l'assistance administrative à la division G.
CHAMP D'APPLICATION DE LA CONVENTION
PERSONNES AUXQUELLES S'APPLIQUE LA CONVENTION
Aux termes de l'article 1 er de la convention, celle-ci s'applique aux personnes physiques, aux personnes morales et à tous les groupements de personnes physiques n'ayant pas la personnalité morale. Cette dernière expression désigne notamment, du côté français, les sociétés en participation, régies par les articles 419 à 422 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales et mentionnées à l'article 206-3 et 4 du Code général des Impôts.
Définition du domicile
En ce qui concerne les personnes physiques, le domicile est, en principe, réputé situé au lieu du « foyer permanent d'habitation », cette expression désignant le centre des intérêts vitaux, c'est-à-dire le lieu auquel le contribuable est attaché par les relations personnelles les plus étroites.
Lorsqu'il n'est pas possible de localiser le domicile d'après ce critère, la personne physique est réputée posséder son domicile dans celui des deux États contractants dans lequel elle séjourne le plus longtemps. En cas de séjour d'égale durée dans les deux États, elle est réputée avoir son domicile dans celui des deux États dont elle est ressortissante.
Si elle n'est ressortissante d'aucun d'eux, les autorités administratives des deux États doivent s'entendre pour trancher la difficuité (conv. art. 2, § 1 ).
Quant aux personnes morales, elles sont domiciliées au lieu de leur siège social statutaire ; les groupements de personnes physiques n'ayant pas la personnalité morale étant, pour leur part, considérés comme ayant leur domicile au lieu du siège de leur direction effective (conv. art. 2, § 2 ).
PORTÉE TERRITORIALE
D'après l'article 1 er , § 2, de la convention, celle-ci s'applique d'une part à la France métropolitaine, et aux départements d'outre-mer (Guadeloupe, Guyane, Martinique et Réunion) et d'autre part, au territoire de la République du Mali.
IMPÔTS VISÉS
1.L'article 8, § 1, de la convention est applicable aux impôts sur le revenu perçus pour le compte de chacun des États contractants et de ses collectivités locales, quel que soit le système de perception.
2.Doivent être considérés comme impôts sur le revenu, les impôts perçus sur l'ensemble du revenu ou sur un ou plusieurs de ses éléments, y compris les impôts sur les plus-values.
3.Les impôts actuels auxquels s'applique expressément la convention sont :
a. En ce qui concerne la France (conv. art. 8, § 3), compte tenu de la législation en vigueur :
- l'impôt sur le revenu,
- l'impôt sur les sociétés, y compris tous précomptes, retenues et avances décomptés de ces impôts ;
b. En ce qui concerne le Mali :
- l'impôt général sur le revenu,
- l'impôt sur les bénéfices agricoles,
- l'impôt sur les revenus fonciers,
- l'impôt sur les revenus de valeurs mobilières,
- l'impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux, y compris tous précomptes, retenues et avances décomptés de ces impôts.
4.Il est prévu que la convention s'appliquera aussi aux impôts futurs de nature identique ou analogue qui s'ajouteraient aux impôts actuels ou qui les remplaceraient (conv. art. 8, § 4).
RÈGLES CONCERNANT L'IMPOSITION DES DIFFÉRENTES CATÉGORIES DE REVENUS
REVENUS IMMOBILIERS
Définition
1.Aux termes du premier alinéa, de l'article 4 de la convention, sont considérés comme biens immobiliers les droits auxquels s'applique la législation fiscale concernant la propriété foncière y compris les droits d'usufruit sur les biens immobiliers. Sont cependant exclues de cette définition les créances de toute nature garanties par gage immobilier.
2.Par ailleurs, le deuxième alinéa de l'article 4 de la convention précise que la notion de biens immobiliers est définie conformément au droit de l'État où est situé le bien considéré.
3.Cette référence à la législation interne - fiscale et générale - confirme, du côté français, le droit de taxer dans le cadre de la règle de la territorialité posée par l'article 9 de la convention, tous les revenus et produits provenant de tels biens lorsque la législation française le prévoit.
4.En conséquence, sont considérés comme revenus de biens immobiliers dans le cadre de la convention les produits des droits sociaux possédés par les associés ou les actionnaires des sociétés qui ont, en fait, pour unique objet soit la construction ou l'acquisition d'immeubles ou de groupes d'immeubles en vue de leur division par fractions destinées à être attribuées à leurs membres en propriété ou en jouissance, soit la gestion de ces immeubles ou groupes d'immeubles ainsi divisés.
Plus précisément, sont concernés par cette disposition :
- les revenus des droits détenus dans les sociétés immobilières dotées de la transparence fiscale en vertu de l'article 30-1 de la loi n° 63-254 du 15 mars 1963 (Code général des Impôts, art. 1655 ter) ;
- les revenus retirés des droits détenus dans des sociétés dont l'actif est constitué principalement par des terrains à bâtir ou des biens assimilés (loi n° 63-1241 du 19 décembre 1963, art. 3, § VI-1 ; Code général des Impôts, art. 150 ter) ;
- les revenus retirés des droits détenus dans des sociétés civiles immobilières de toute nature non régies par l'article 30-I de la loi du 15 mars 1963 précitée et dont le patrimoine est composé essentiellement par des immeubles autres que des terrains à usage agricole ou forestier ( loi du 19 décembre 1963, art. 4 , § II, Code général des Impôts, art. 150 quinquies I ).
Règles d'imposition
1.Conformément aux dispositions de l'article 9 de la convention, l'imposition des revenus des biens immobiliers est attribuée à l'État où ces biens sont situés.
2.Cette règle s'applique, selon l'acception propre à la législation française, non seulement aux revenus proprement dits des biens dont il s'agit, mais également aux plus-values immobilières visées aux articles 28 et 29 de la loi du 15 mars 1963 et aux articles 3 et 4 de la loi du 19 décembre 1963 (Code général des Impôts, art. 150 ter à quinquies, 235 quater, 238 octies à undecies, 244 bis ).
BÉNÉFICES AGRICOLES
La règle de l'imposition dans l'État de la situation des biens est également applicable, conformément aux dispositions de l'article 9 de la convention, aux revenus provenant des exploitations agricoles et forestières.
Les bénéfices produits par ces entreprises sont imposables, dans chaque État, dans les conditions prévues par la législation interne.
BÉNÉFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX
A l'exception des revenus provenant des entreprises de navigation aérienne et maritime visées ci-après ( cf. n° 2333 ), les bénéfices industriels et commerciaux sont imposables dans l'État sur le territoire duquel se trouve un établissement stable de l'entreprise (conv. art. 10, § 1) .
Définition de l'établissement stable
1.Aux termes de l'article 3 de la convention, l'expression « établissement stable » désigne une installation fixe d'affaires où une entreprise exerce tout ou partie de son activité.
2.Constituent notamment des « établissements stables », un siège de direction, une succursale, un bureau, une usine, un atelier, une mine, carrière ou autre lieu d'extraction de ressources naturelles.
3.Il est à noter que la convention franco-malienne comporte une définition de l'établissement stable relativement large.
Ainsi, l'article 3 prévoit que constituent notamment des établissements stables :
- un chantier de montage au même titre qu'un chantier de construction ;
- une installation fixe d'affaires utilisée aux fins de stockage, d'exposition et de livraison de marchandises appartenant à l'entreprise ;
- un dépôt de marchandises appartenant à l'entreprise entreposées aux fins de stockage, d'exposition et de livraison ;
- une installation fixe d'affaires utilisée aux fins d'acheter des marchandises ou de réunir des informations faisant l'objet même de l'activité de l'entreprise ;
- une installation fixe d'affaires utilisée à des fins de publicité ;
- un agent dépendant disposant de pouvoirs lui permettant de conclure des contrats au nom de l'entreprise.
4.En revanche, ne constituent pas des établissements stables :
- les dépôts de marchandises entreposées aux seules fins de transformation par une autre entreprise ;
- les installations fixes d'affaires utilisées aux seules fins de publicité, de fournitures d'informations, de recherche scientifique ou d'activités analogues, ayant pour l'entreprise un caractère préparatoire.
5.D'autre part, les paragraphes e et f de l'article 3 de la convention précisent, au regard de la notion d'établissement stable, les situations respectives des entreprises utilisant le concours d'intermédiaires ou de représentants autonomes et des entreprises associées.
6.Enfin, il est précisé au paragraphe d de l'article 3 qu'une entreprise d'assurances de l'un des États contractants est considérée comme ayant un établissement stable dans l'autre État contractant dès l'instant que, par l'intermédiaire d'un représentant qui ne peut être regardé comme un agent indépendant en vertu du paragraphe e du même article (cf. supra 2331-5), elle perçoit des primes sur le territoire de ce dernier État ou assure des risques situés sur ce territoire.
Détermination du bénéfice imposable
1.Les bénéfices industriels et commerciaux réalisés par une entreprise de l'un des États contractants sur le territoire de l'autre État, sont imposables dans cet autre État, mais uniquement dans la mesure où les bénéfices sont imputables à l'établissement stable qui se trouve situé dans cet autre État (conv. art. 10, § 1 et 2).
2.Le bénéfice de l'établissement stable est déterminé dans les conditions fixées aux paragraphes 3 à 5 de l'article 10.
3.Conformément aux dispositions de l'article 10, paragraphe 3, le bénéfice imposable de l'établissement stable doit être déterminé d'après les résultats de la comptabilité en tenant compte, éventuellement, d'une quote-part des frais généraux du siègé social de l'entreprise. Cette quote-part de frais généraux est imputée sur les résultats des différents établissements stables au prorata du chiffre d'affaires réalisé par chacun d'eux.
4.Le bénéfice de l'établissement stable doit correspondre au bénéfice que l'établissement aurait normalement réalisé s'il avait constitué une entreprise autonome.
Le bénéfice de l'établissement stable comprend donc, le cas échéant, des bénéfices qui auraient dû normalement lui être affectés mais qui ont été indirectement transférés à d'autres établissements de l'entreprise par suite des conditions particulières qui lui étaient imposées dans ses relations commerciales ou financières avec ces établissements (art. 11 de la convention) .
5.A défaut de comptabilité distincte, le bénéfice imputable à chacun des établissements stables que l'entreprise possède dans les deux États contractants peut être déterminé par répartition des résultats globaux de l'entreprise au prorata du chiffre d'affaires réalisé dans chacun d'eux ( conv. art. 10, § 4 ).
6.Lorsque cette règle ne peut s'appliquer, soit parce que l'établissement ne réalise pas de chiffre d'affaires, soit parce que l'activité exercée n'est pas comparable à celle des autres établissements de l'entreprise, les autorités compétentes des deux États s'entendent pour arrêter les conditions de la ventilation des bénéfices (conv. art. 10, § 5).
Dans une telle hypothèse, il appartiendra au service de saisir la Direction générale (Service de la Législation, sous-direction III E, bureau III E 2) en fournissant tous les éléments d'informations nécessaires.